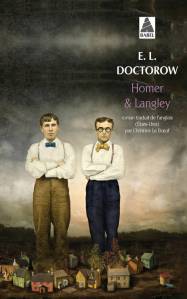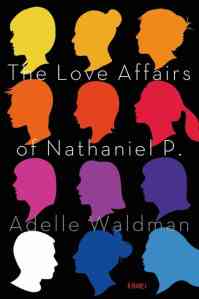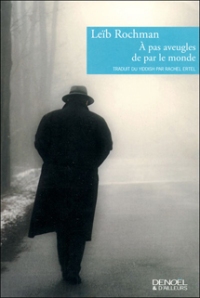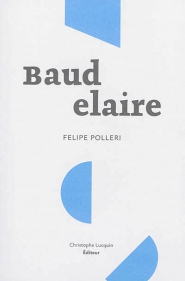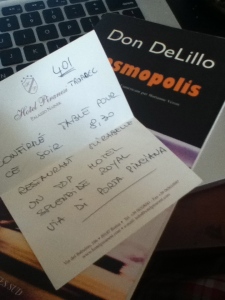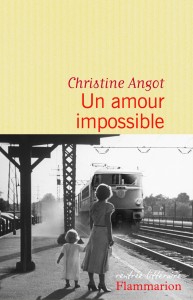 Parfois, on est trop gentils. Il m’arrive de céder, puis de me reprocher mon absence d’inflexibilité. Christine Angot publie en cette rentrée littéraire Un amour impossible, chez Flammarion. Il y a deux ans, j’avais déjà écrit ce que je pensais d’Une semaine de vacances, son précédent roman. Je n’avais pas été particulièrement enthousiaste, s’il faut employer ici un euphémisme de bon ton. Plus que la qualité tout à fait contestable de ce roman, c’était la réception qui en avait été faite, absolument démentielle au vu de la réalité du texte, qui m’avait interloqué, et rapidement agacé. Le temps des rentrées littéraires est de toute évidence cyclique, et aujourd’hui donc, nul doute que Christine Angot et son Un amour impossible connaîtra le même accueil qu’à l’accoutumée.
Parfois, on est trop gentils. Il m’arrive de céder, puis de me reprocher mon absence d’inflexibilité. Christine Angot publie en cette rentrée littéraire Un amour impossible, chez Flammarion. Il y a deux ans, j’avais déjà écrit ce que je pensais d’Une semaine de vacances, son précédent roman. Je n’avais pas été particulièrement enthousiaste, s’il faut employer ici un euphémisme de bon ton. Plus que la qualité tout à fait contestable de ce roman, c’était la réception qui en avait été faite, absolument démentielle au vu de la réalité du texte, qui m’avait interloqué, et rapidement agacé. Le temps des rentrées littéraires est de toute évidence cyclique, et aujourd’hui donc, nul doute que Christine Angot et son Un amour impossible connaîtra le même accueil qu’à l’accoutumée.
Parfois donc, on est trop gentils. Par acquis de conscience, pour ne pas parler dans le vide, pour ne pas être bêtement méchant et critiquer un livre que je n’aurais pas lu, je me suis donc procuré Un amour impossible qui, depuis le bandeau qui cerne le livre, au résumé qui en est fait par l’éditeur, est présenté d’une façon beaucoup plus romanesque que ce à quoi nous a habitué l’auteur, bien que ce roman se fonde sur une histoire vraie, en l’occurrence, celle des ses parents, Rachel Schwartz et Pierre Angot, qui ont vécu, dans les années 1950 à Chateauroux, la ville natale de l’auteur, une passion dévorante mais courte.
Le roman commence donc de manière ultra classique : « Mon père et ma mère se sont rencontrés à Chateauroux, près de l’avenue de la Gare, dans la cantine qu’elle fréquentait, à vingt-six ans elle était déjà à la Sécurité sociale depuis plusieurs années, elle a commencé à travailler à dix-sept ans comme dactylo dans un garage, lui après de longues études, à trente ans, c’était son premier poste. » Le ton est donné d’emblée, froid, descriptif. La langue, si elle n’est pas particulièrement remarquable, est en tout cas assez épurée pour passer pour un style. Cette impression, il faut le concéder, dure au cours des vingts premières pages qui, là encore, si elles n’ont rien d’extraordinaire, se lisent sans déplaisir mais sans passion non plus. L’ennui pointe déjà son nez : les premiers instants de cette histoire d’amour naissante nous sont présentés de manière très factuelle, si bien que le lecteur a peine à se sentir concerné par ce qui est décrit : le style de l’auteur ronronne, scandé par des structures sujet-verbe-complément qui ont autant de relief qu’un paysage de plage en Belgique. Tout l’intérêt que le lecteur aurait pu avoir au début du roman décroît au fur et à mesure que le texte se transforme en un procès-verbal. C’est d’autant plus désespérant que l’auteur, au début de sa carrière, avait au moins une langue, un style syncopé qui parvenait vraiment à créer du rythme, à nous emporter. Ici, il n’y a plus rien : ni rythme ni langue ni voix. Comment donc parvenir à trouver, en tant que lecteur, quelque chose à quoi se raccrocher ?
Très vite, Christine Angot, en tant que personnage (elle vient de naître suite à la rencontre de ses parents), intervient dans le texte, et là, tout s’effondre. Ce qui n’était déjà pas très brillant devient carrément insupportable d’ennui, de trivialité, et de banalité. Tout y passe : la vie avec Maman et Mémé, les premières règles de Christine, Christine « a du poil aux fesses » (dixit sa cousine), puis la volonté de sa mère de faire reconnaître Christine par son père et de faire enlever la mention « née de père inconnu », le tout entrecoupé de la correspondance des deux parents, avec les promesses puis fuites, puis repromesses puis refuites du père… Soyons clairs : ce n’est pas le contenu du livre que je regrette. Après tout, je suis persuadé qu’un écrivain avec assez de puissance aurait de la puissance pour parler de n’importe quoi, des premières règles adolescentes comme des plus grandes tragédies, des patates douces ou d’un kilo de merlan. Mais pour cela, il faudrait qu’il y ait du style, une langue, et plus encore : une vision. Or, le roman de Christine Angot en est dépourvu de bout en bout. À la place, on y trouve des dialogues à la limite du tolérable.
C’est d’ailleurs grâce à ces dialogues qu’est perceptible ce que doit être le projet d’Angot, si d’aventure elle en a un. Angot, en effet, dans la fameuse émission Bouillon de Culture où elle atomisa Jean-Marie Laclavetine, éditeur chez Gallimard, avait déclaré qu’en écrivant L’Inceste, elle voulait prendre le risque de faire quelque chose de « pas littéraire ». Sans doute poursuit-elle ce projet, car ces dernières années, elle a renoncé à tout ce qui avait fait la marque de son style, et a évolué vers une platitude, peut-être revendiquée. Ce ne sont là que mes hypothèses. Écrire plat pour montrer la vie comme elle va, ou plutôt, comme Angot le dit elle-même, écrire plat pour que les choses écrites soient tout de suite visibles, sans médiation ; c’est là le rêve des ces écrivains qui considèrent le langage et le style comme une vitre ou un paravent, et dont le projet est de les réduire au maximum, comme si les choses dont on parlait importaient plus que la façon dont on en parle. Ce n’est pas un rêve que je partage, et ce n’est pas un objectif que j’aime en littérature. Sans doute est-il intéressant quand il est réalisé avec art. Mais sans art, il ne peut être que ce que nous livre Christine Angot : la platitude, l’ennui, les conversations interminables, les débats sur l’opportunité de manger ou non des huitres à Strasbourg, les exclamations extatiques sur le goût succulent d’une viande au restaurant1… jusqu’aux vingt dernières pages du roman, où Christine se remet à parler avec sa mère après des années de silence, et où elle l’interroge sur son aveuglement. Comment sa mère avait-elle pu laisser son père la violer, des années durant, sans s’en douter ?
Ces vingts pages sont particulièrement éprouvantes à lire, non pas en raison d’un sujet qui, par nature, l’est, mais parce qu’elles auraient pu être le point culminant du roman, et elles ne sont, encore une fois (je me répète, car je ne trouve pas de mots), un sommet de platitude qui fait songer, au choix, à une telenovela mexicaine captée sur la TNT une nuit d’insomnie, ou à un condensé de psychologie de magazine féminin, à base de « Tu attendais de rencontrer un méchant » (l’attrait légendaire pour le bad boy qui nourrit tant de fictions adolescentes) et de « Les choses intimes sont les plus difficiles à exprimer » (sans blague ? ). Ces pages sont sans doute la preuve la plus flagrante de l’absence de vision de Christine Angot dans Un amour impossible. Sans style, il n’y a pas de vision. Avec un style médiocre, la vision est médiocre.
Elles provoquent en plus chez le lecteur, la sensation désagréable qu’on nous écrit ce que nous aurions dû déjà comprendre si le texte qui les précède avait été à la hauteur. De là l’impression tenace que nous avons, en tournant la dernière page de ce roman, qu’elles constituent un aveu de faiblesse d’un auteur qui se sent le besoin d’expliquer sa prose. Une prose n’a pas besoin d’explication quand elle est juste.
Un amour impossible, de Christine Angot, Flammarion, 18 euros.
1 Afin de ne pas parler dans le vide et de vous laisser juger par vous-mêmes, voici un extrait d’un dialogue tel qu’on en trouve de trop nombreux dans ce roman :
« – Oh qu’est ce qu’elle est bonne, Pierre, cette viande !
Il en a coupé un morceau et l’a mis dans sa bouche.
– Humm.
Il a fermé les yeux pour mieux l’apprécier.
– Elle est bonne hein Pierre !?
– Humm !… Ah oui. C’est rare une bonne pièce de viande. Humm !… Comme celle-ci. Bien tendre. Humm !…
– Une bonne entrecôte c’est délicieux. Elle est très bonne la viande Pierre. Tu nous as amenés dans un excellent endroit. C’est un peu abondant, mais vraiment très bon.
– Ce qui me manque en Alsace, moi, ce sont les fruits de la mer. Je ne mange jamais d’huîtres à Strasbourg, tu sais ! »
« Le redoublement de la consonne dans l’interjection chez Christine Angot. » Vous avez quatre heures.